Au
moment où le trône de France est entre les mains de Hugues
Capet, en 987, une nouvelle dynastie est fondée. Elle va grandir
en s'alliant avec l'Eglise, assurant ainsi sa durée dans le temps.
La Grande Institution est la maîtresse de bien des lieux, de par la
présence de saints-martyrs déposés çà
et là, en Bourgogne.
La transition entre l'époque carolingienne et celle capétienne
se fait en douceur et permet le développement d'Argilly et l'extension
des sites alentours.
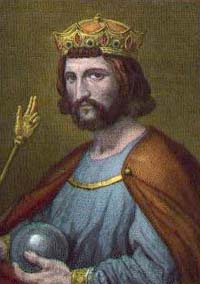
(Portrait d'Hugues Capet)
L'an Mil apporte son lot de misères : les épidémies de peste et surtout de lèpre font se monter diverses léproseries (une par village important).
Le Duc de Bourgogne devient le propriétaire personnel de cette région voisine du sud dijonnais : soit par la force, soit par l'achat de terres. Les relations entre le personnage et l'Eglise, grande propriétaire dans le secteur, ne sont pas toujours très calmes. Cîteaux est donné en 1098, ainsi que certains droits, à des moines, mais ne suffit pas à calmer les querelles. Les seigneurs locaux, et principalement de Vergy et de Baissey, n'entendent pas se laisser déposséder. De grandes familles seigneuriales sont là, haussant le ton : la région ne tombera pas toute dans les mains des religieux. Ceux-ci achètent (des chemins, des terres près du Moulin de la Chaume, à Longvay...), bâtissent, usent de droits non acquis mais juste tolérés. La réponse des seigneurs est parfois violente (destruction de Gevrey et d'une partie de Cîteaux).

(Abbaye de Citeaux)
Des jugements concernant ces batailles parfois sanglantes sont pris à Argilly. D'ailleurs, d'autres actes administratifs sont établis en cet endroit, et qui concernent parfois le duché tout entier. Le site est réellement important (une tuilerie, divers ateliers) et entraîne l'affirmation des familles locales : les De Gerland et d'autres seigneurs. L'importance des titres va de pair avec l'affranchissement des sites dépendant de ces nobles : Nuits en 1212, puis Argilly et Bagnot, en 1234. Les droits en découlant entraînent la création de villages et de fiefs : Chandeland, Champgerley, Lée. L'église d'Argilly grandit en conséquence et atteint presque sa dimension actuelle (choeur et transept) en 1266.

(Eglise d'Argilly)
Mais ce qui fait la valeur du territoire sont, plus que les revenus des impôts, la chasse et les plaisirs de la vie de l'époque (notamment les festins). Le Duc et de grands personnages fréquentent Argilly un certain temps, amenant de l'argent dans le secteur. Nuits tire profit du vin qui se vend bien, comme les villages de la plaine le font avec leurs productions céréalières. Les moulins se montent, et, quand la fréquentation du lieu baisse, ce sont eux qui assurent la vie de cette campagne par la vente de leurs farines ou de leurs tissus.
La
reprise économique locale se fait lorsque le Duc revient peu à
peu dans son château d'Argilly. De là, il reprend ses habitudes
et, entre périodes de chasse et de repos, il traite aussi bien des
affaires locales que de celles de la Bourgogne. Le château est l'objet
d'un
nouvel embellissement : une chapelle est montée en juillet 1345. Du
coup, toute la région retrouve l'intérêt que lui portaient
les seigneurs quelques temps auparavant.


(Reconstitutions du château et de la chapelle)
La
guerre de Cent ans, qui apporte son lot de malheurs depuis longtemps, fait
que la Bourgogne est bientôt conquise par les Anglais, auxquels s'ajoutent
les Comtois. La situation d'Argilly et de ses environs est très bonne,
malgré les soucis de la couronne ducale
de Bourgogne, et suscite beaucoup de convoitises. Les nobles bourguignons,
dont les armées ont été défaites, sont inquiets.
D'autant que le dernier duc capétien meurt jeune, une forte
rançon reste à verser et des droits sont à reconnaître
aux Anglais.
Le duché est, de plus, sans successeur immédiat. L'avenir est
donc plus qu'incertain...
Extrait du livre d'Etienne Breton-Leroy. En savoir plus...